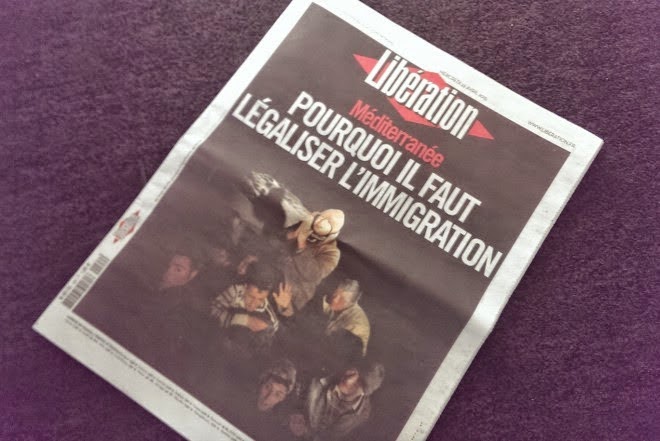« Le
discours de vérité ne peut pas avoir la majorité (…) les peuples aiment qu’on
les fasse rêver » : voilà ce qu’a dit Daniel Cohn Bendit
mardi matin sur Europe 1 au sujet de
la Grèce et des promesses de Syriza lors de la campagne de début d’année. Un
jugement révélateur à plusieurs titres.
Un
aristocrate xénophobe
Daniel Cohn
Bendit est une personne que beaucoup trouvent sympathique, même quand ils ne
sont pas d’accord avec lui. Pourtant, voici
un jugement d’une suffisance toute aristocratie, dont il est difficile de ne
pas sentir une forme de mépris pour le peuple, implicitement trop stupide
et manipulable par les démagogues pour saisir ce qu’il faudrait faire. Car dans
le jugement de Daniel Cohn-Bendit, il y a un profond sentiment de supériorité,
pas même bourgeois, mais bien plus digne des nobliaux et des aristocrates du
Moyen-Age qui se croyaient infiniment supérieurs au petit peuple. Il n’est pas
peu ironique de constater l’évolution idéologique de celui qui portait la
révolte de 1968 et qui
dit implicitement que ce qu’il pense, comme le reste des élites, a plus de
valeur que ce que ressent le bas peuple.
En fait, on
peut même distinguer une forme de racisme de classe, ce qui n’est pas peu
ironique non plus de la part d’une personne toujours aussi prompte à dénoncer
la xénophobie réelle ou supposée de quiconque critique des étrangers ou des
immigrés, ou, encore pire, semble conserver le moindre attachement à cette
notion qu’il ne semble plus saisir, la nation. Par cette phrase, Daniel
Cohn-Bendit est dans la même logique que Jean-Marie Le Pen quand il dérape sur
les noirs, les juifs ou les étrangers. Quelle serait sa réaction si le
président du FN affirmait que les noirs étaient moins intelligents ? Mais
ici, personne ne va s’émouvoir du fait que
Daniel Cohn-Bendit juge le peuple un peu stupide…
La fin de
la démocratie ?